Certains des organismes qui causent des maladies tropicales sont des bactéries et des virus, des termes qui peuvent être familiers à la plupart des gens car ces types d’organismes causent des maladies courantes.
Les organismes plus complexes communément appelés parasites sont moins connus. Tous ces types d’agents peuvent être appelés génériquement agents pathogènes, c’est-à-dire tout organisme qui cause une maladie.
Dans les zones climatiques tempérées, de nombreuses maladies virales et bactériennes familières se transmettent directement de personne à personne, par voie aérienne ou par contact sexuel. Sous les tropiques, les maladies respiratoires (telles que la rougeole, le virus respiratoire syncytial, la tuberculose) et les maladies sexuellement transmissibles revêtent également une grande importance.
En outre, de nombreuses maladies sont propagées par des sources d’eau et de nourriture contaminées, car l’eau potable et les conditions sanitaires sont souvent un luxe dans les pays en développement.
Alternativement, certains agents de maladies tropicales sont transmis par un vecteur intermédiaire. L’insecte ou un autre vecteur invertébré attrape l’agent pathogène d’une personne ou d’un animal infecté et le transmet à d’autres en train de se nourrir. Souvent, les agents pathogènes tropicaux doivent subir d’importants changements de développement au sein du vecteur avant qu’ils n’achèvent leur cycle de vie et redeviennent infectieux pour l’homme.
Lire aussi: Médecine Africaine, entre Ciel et Terre
Les maladies tropicales provenant des Virus
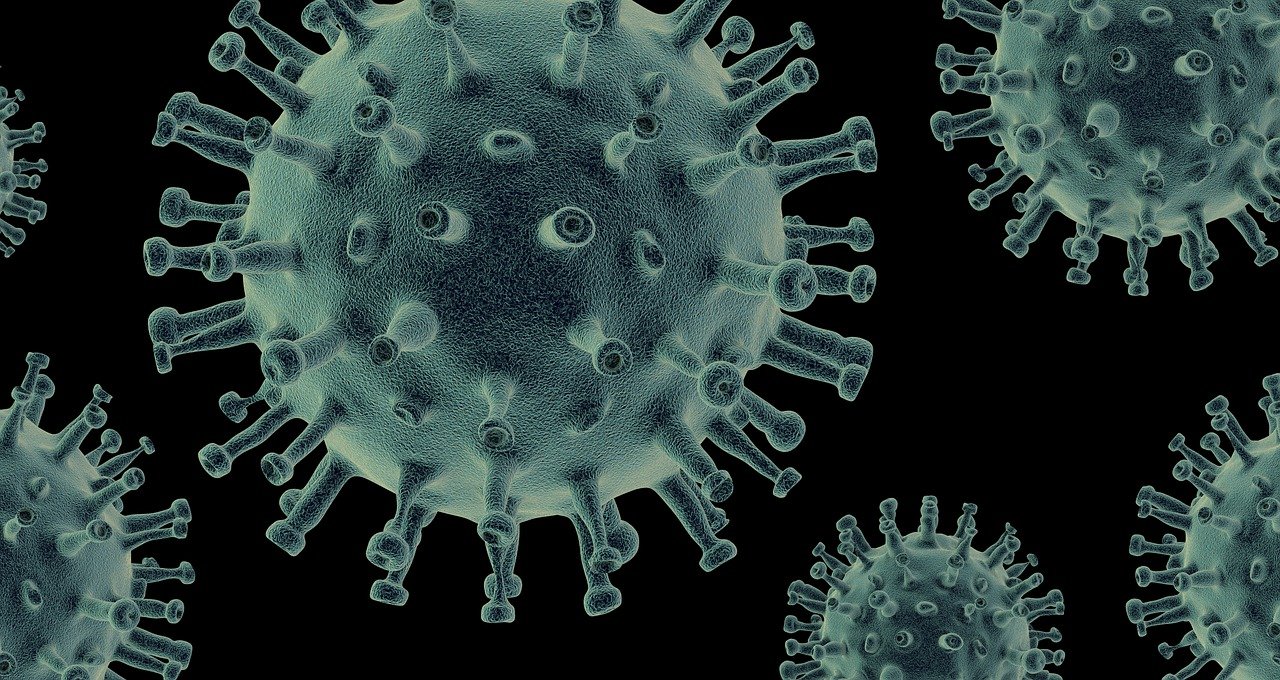
Les virus sont de minuscules agents infectieux qui ne sont généralement constitués que de matériel génétique recouvert d’une enveloppe protéique. Ils ne se répliquent qu’à l’intérieur des cellules, qui fournissent la machinerie synthétique nécessaire pour produire de nouvelles particules virales.
Arbovirus
Le terme « arbovirus » est l’ abréviation de « virus transmis par les arthropodes ». Les arthropodes comprennent de nombreux insectes importants sur le plan médical (moustiques, tiques, mouches, etc.) qui peuvent transmettre des agents pathogènes aux humains. Les arbovirus sont particulièrement importants en tant que maladies tropicales.
Dengue la fièvre, causée par un flavivirus transmis par les moustiques, se trouve dans les régions tropicales et sub – tropicales des Amériques, en Afrique, en Asie et en Australie. Dans sa forme aiguë, la dengue se caractérise par des symptômes pseudo-grippaux, notamment des douleurs intenses à la tête, aux yeux, aux muscles et aux articulations.
Certains patients, en particulier les nourrissons et les enfants, développent une « fièvre hémorragique dengue », une variation sévère et parfois mortelle impliquant une insuffisance circulatoire et un choc.
L’incidence des deux formes d’infection de la dengue a récemment augmenté, car l’urbanisation croissante agrandit les régions habitées par le moustique vecteur Aedes . Des moustiques capables de transmettre cette maladie se trouvent également aux États-Unis.
La fièvre jaune est une autre maladie arbovirale, caractérisée par de la fièvre, des hémorragies et des complications hépatiques souvent mortelles. Elle est limitée à l’Amérique du Sud tropicale et à l’Afrique, où elle est parfois épidémique malgré l’existence d’un vaccin sûr et efficace. Le potentiel d’augmentation de l’incidence de la fièvre jaune semble augmenter avec l’expansion de la distribution des moustiques vecteurs Aedes .
Rotavirus provoque la diarrhée aqueuse et des vomissements, principalement chez les jeunes enfants. Ces virus sont distribués dans le monde entier et la transmission est généralement due au contact avec des personnes infectées ou des objets contaminés par des matières fécales. La majorité des infections sont spontanément résolutives, mais la mortalité infantile est plus élevée dans les pays en développement et est généralement associée à une déshydratation sévère. Comme pour le choléra, le traitement consiste à remplacer les liquides et les électrolytes perdus.
 le SIDA
le SIDA
Les virus de l’immunodéficience humaine (VIH) associés au syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) se sont répandus dans les pays en développement.
En 1996, plus de 13 millions d’adultes vivaient avec le VIH en Afrique subsaharienne, ce qui représente environ 60 % du nombre mondial de personnes infectées. La propagation du VIH dans cette région a été exacerbée par les crises récentes, telles que les catastrophes naturelles et les conflits armés, qui ont entraîné des mouvements massifs de population.
Le nombre d’individus infectés en Asie augmente également rapidement ; on estime actuellement que plus de 5 millions de personnes vivent avec le VIH/SIDA en Asie du Sud et du Sud-Est.
L’érosion progressive du système immunitaire dont souffrent les personnes infectées par le VIH les rend plus sensibles à d’autres infections. Souvent, ces infections secondaires (ou « opportunistes ») sont atypiques ou plus graves qu’elles n’apparaîtraient chez une personne immunocompétente.
Étant donné que différentes maladies sont prédominantes dans les régions tropicales, les schémas des infections associées au VIH peuvent diverger considérablement de ceux observés dans les pays développés. De plus, on pense qu’être infecté par une ou plusieurs maladies tropicales peut affecter l’évolution du SIDA lors d’une infection ultérieure par le VIH.
Ebola
Le virus Ebola provoque de la fièvre, des maux de tête sévères, des maux de dos, des vomissements, de la diarrhée et des hémorragies sévères. La méthode par laquelle Ebola est transmis dans la nature, et quel animal est son hôte naturel, reste flou.
Lors d’épidémies récentes comme celles qui se sont produites au Zaïre, au Soudan et au Gabon, le premier contact de l’homme avec le virus a clairement été accidentel. Cependant, lorsque les humains contractent l’infection, elle se propage rapidement aux personnes en contact avec les fluides corporels du patient et le taux de mortalité est très élevé.
Le virus de Marburg est lié à Ebola, mais a généralement un taux de mortalité un peu plus faible.
La fièvre de Lassa est un autre virus de la fièvre hémorragique souvent mortelle. Elle est transmise par les rongeurs. Les symptômes de la fièvre de Lassa comprennent des maux de dos et/ou des maux de tête aigus, des maux de gorge, de la fièvre, des éruptions cutanées, une déshydratation, un gonflement général, des hémorragies cutanées, des battements cardiaques irréguliers et une désorientation.
Les virus à l’origine de plusieurs types de fièvres hémorragiques sud-américaines appartiennent à la famille des arénavirus comme Lassa, et sont également véhiculés par les rongeurs.
Les bactéries
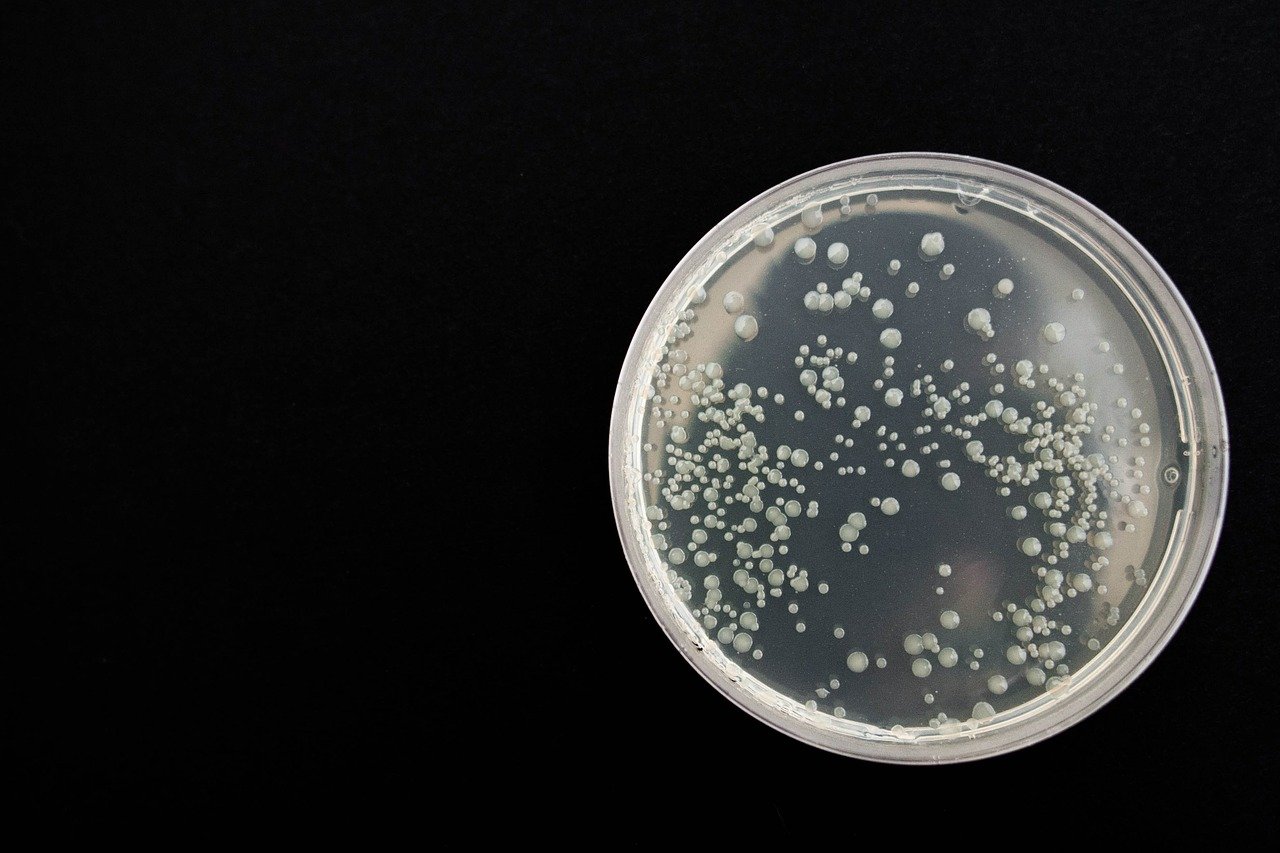
Les bactéries sont plus complexes que les virus, contenant des informations génétiques et une grande partie de l’équipement nécessaire pour produire de l’énergie et se répliquer indépendamment. Certaines bactéries, cependant, ne peuvent se reproduire que lorsqu’elles se développent à l’intérieur d’une cellule, à partir de laquelle elles tirent les nutriments nécessaires
Le choléra est une maladie diarrhéique provoquée par l’ infection par Vibrio cholerae, une bactérie le plus souvent dans l’ eau contaminée et les crustacés, ce qui produit une toxine qui perturbe l’équilibre biochimique des cellules qui tapissent l’intestin et les rend sécrètent copieux quantités d’eau et d’électrolytes.
Le choléra est endémique dans un certain nombre de pays tropicaux, et périodiquement des épidémies majeures éclatent comme celle touchant quelque 900 000 personnes en Amérique du Sud entre 1991 et 1993.
Le choléra se caractérise par une diarrhée aqueuse grave qui, si elle n’est pas traitée, peut entraîner une déshydratation grave et la mort. Le traitement consiste à remplacer l’eau, les sels et le sucre perdus.
Escherichia coli La bactérie Escherichia coli , plus connue sous le nom de E. coli , peut produire des toxines similaires à celles de la bactérie du choléra, provoquant des maladies allant de la diarrhée du voyageur à la diarrhée persistante avec malnutrition.
Une forme extrêmement pathogène de ces bactéries provoque une diarrhée sanglante et des complications rénales, comme récemment observées lors d’épidémies aux États-Unis, au Japon et en Écosse, qui peuvent être mortelles, en particulier chez les enfants et les personnes âgées. Cette forme, parfois connue sous le nom de 0157:H7 ou EHEC ( E. coli entérohémorragique ) est souvent associée à l’ingestion de viande insuffisamment cuite, mais a également été trouvée dans d’autres aliments, y compris le lait non pasteurisé et les jus de fruits.
Tuberculose
Causée principalement par la bactérie Mycobacterium tuberculosis, il s’agit d’une infection qui peut durer toute une vie, entraînant une maladie de pratiquement tous les organes dans le corps mais affecte principalement les poumons. La tuberculose sévit partout dans le monde.
Jusqu’à récemment, on pensait qu’elle était bien contrôlée dans les pays les plus développés ; malheureusement, cependant, il est à nouveau en augmentation en raison de son association en tant qu’infection opportuniste du SIDA et de sa prévalence chez les toxicomanes. La tuberculose reste un problème majeur dans le monde en développement, où les conditions de pauvreté, de malnutrition et de surpeuplement contribuent à sa prévalence.
On estime que 5 à 15 % des individus infectés développent la maladie. La tuberculose pulmonaire est la manifestation la plus courante dans le monde et est associée à la fatigue, à la perte de poids, à la toux et à des difficultés respiratoires. Plusieurs médicaments sont disponibles, mais les inconvénients incluent la nécessité d’un traitement long et le développement croissant de la résistance aux médicaments par la bactérie.
Maladie de Hansen, également connue sous le nom de lèpre, est causée par la bactérie Mycobacterium leprae, qui est apparentée à l’agent responsable de la tuberculose.
Il y a 3,7 millions de cas officiellement enregistrés, mais le nombre réel d’individus infectés est au moins deux à trois fois plus élevé. Le mécanisme exact de transmission de personne à personne reste inconnu, mais implique probablement un contact avec une peau infectée ou des sécrétions nasales.
Les bactéries se développent principalement dans les cellules tissulaires appelées macrophages (littéralement « gros mangeurs », ces cellules sont des composants importants du système immunitaire) de la peau et dans les cellules de Schwann entourant les nerfs. Comme dans le cas de certaines maladies parasitaires, la réaction de l’organisme au bacille de la lèpre est responsable de la maladie.
L’évolution clinique de la lèpre est extrêmement variable. Certaines personnes infectées peuvent rester sans symptômes. Dans sa pire forme, la croissance bactérienne est incontrôlée, entraînant une perte de sensation dans la zone touchée, ce qui peut prédisposer à un traumatisme et à une déformation conséquente.
Actuellement, aucune méthode de prévention n’existe. Le traitement repose sur l’administration à long terme d’antibiotiques. Des difficultés sont rencontrées en raison du développement de la résistance aux médicaments et du non-respect des schémas thérapeutiques par les patients.
Les parasites
 Les parasites sont des organismes qui vivent à l’intérieur ou sur un autre organisme, l’hôte, aux dépens duquel ils obtiennent un avantage tel que la nourriture. Ce groupe d’agents pathogènes comprend les protozoaires (organismes unicellulaires plus complexes que les bactéries) et les helminthes (organismes multicellulaires communément appelés vers).
Les parasites sont des organismes qui vivent à l’intérieur ou sur un autre organisme, l’hôte, aux dépens duquel ils obtiennent un avantage tel que la nourriture. Ce groupe d’agents pathogènes comprend les protozoaires (organismes unicellulaires plus complexes que les bactéries) et les helminthes (organismes multicellulaires communément appelés vers).
Ainsi, les parasites peuvent aller des protozoaires microscopiques aux vers atteignant trois pieds de long. L’environnement dans lequel les parasites peuvent vivre est spectaculairement diversifié : différents types de protozoaires peuvent s’installer dans les globules rouges, les globules blancs (y compris ceux qui sont normalement responsables de la destruction des micro-organismes intrus), les cellules musculaires, les cellules du cerveau, les cellules cardiaques, le foie cellules et autres, ou ils peuvent vivre de manière extracellulaire dans des sites tels que le sang, les tissus ou les sécrétions muqueuses.
Incroyablement, certains types de vers peuvent également vivre dans les cellules, mais pour la plupart, ils vivent de manière extracellulaire dans l’intestin, le sang, les vaisseaux lymphatiques ou les tissus de la peau, des yeux et ailleurs.
Contrairement aux bactéries et aux virus, de nombreux types de parasites subissent des transformations développementales complexes, impliquant une croissance chez les hôtes mammifères et invertébrés ainsi que des types de reproduction sexuée et asexuée, au cours de leurs cycles de vie compliqués.
Paludisme
Plus de 300 millions de personnes développent des cas cliniques de paludisme chaque année, et un à trois millions d’entre elles en meurent. Beaucoup d’entre eux sont des enfants vivant en Afrique subsaharienne.
Près de la moitié de la population mondiale vit dans une région où elle risque de contracter la maladie. Le paludisme est causé par des protozoaires du genre Plasmodium. Chacune des quatre espèces de parasites du paludisme qui infectent l’homme provoque une forme quelque peu différente de la maladie.
Le paludisme causé par P . falciparum est la forme la plus dangereuse et représente l’écrasante majorité des décès. À moins d’être traitée de manière appropriée, elle peut entraîner plusieurs complications potentiellement mortelles, notamment une insuffisance rénale et un coma.
Les parasites sont transmis à l’homme par les moustiques anophèles femelles. Lorsque le moustique prend un repas de sang sur l’hôte, il injecte les parasites avec sa salive. Les parasites se développent d’abord dans les cellules du foie, puis infectent les globules rouges (érythrocytes), où ils consomment l’hémoglobine, le composant du sang qui transporte l’oxygène.
Les parasites se divisent dans le globule rouge et, à la fin du développement, le globule rouge se rompt, libérant des parasites qui peuvent infecter de nombreux autres érythrocytes. Les symptômes typiques du paludisme, des cycles de frissons, de fièvre et de transpiration, sont ressentis par les patients à ces moments-là.
En 1955, l’Organisation mondiale de la santé a lancé une vaste campagne, utilisant des insecticides et des médicaments, pour éradiquer le paludisme. Malgré un certain nombre de succès spectaculaires, l’objectif s’est avéré insaisissable. Les moustiques ont non seulement modifié leur comportement pour éviter d’entrer en contact avec des insecticides, mais ont en fait développé une résistance à ces produits chimiques.
Les parasites sont également devenus résistants à la chloroquine, un médicament largement utilisé, et à d’autres antipaludiques. De plus en plus de preuves montrent que le paludisme reprend le dessus. Des zones exemptes de paludisme ont connu des épidémies et le nombre de cas a augmenté de manière alarmante en Amazonie et dans certaines parties de l’Asie, en particulier en Asie du Sud-Est. En Afrique, le paludisme s’est déplacé des zones rurales vers les villes.
À une certaine époque, le paludisme était un grave problème de santé aux États-Unis ; en 1914, plus de 600 000 cas de paludisme se sont produits là-bas. Bien que l’amélioration de la santé publique ait entraîné un déclin substantiel au cours des décennies suivantes, des résurgences mineures se sont produites lorsque les troupes sont revenues des guerres de Corée et du Vietnam.
Plus récemment, des cas de paludisme transmis localement sont apparus dans des régions aussi diverses que la Californie, la Floride, le New Jersey, New York, le Texas et le Michigan.
Leishmaniose La leishmaniose est en fait un groupe de maladies, causées par une infection par des protozoaires appartenant au genre Leishmania . Il existe environ 20 espèces différentes qui sont transmises à l’homme par la piqûre de phlébotomes femelles infectés. Chez l’hôte mammifère, le parasite se trouve dans les macrophages. Ces cellules sont généralement responsables de la destruction des micro-organismes envahisseurs, et la remarquable capacité des parasites leishmaniens à échapper à leurs mécanismes antimicrobiens a suscité un intérêt scientifique considérable.
Comme le paludisme, la leishmaniose est largement répandue dans de grandes parties des régions tropicales et subtropicales du monde, y compris des parties du sud de l’Europe. Des cas ont été rapportés de manière anecdotique dans le sud-ouest des États-Unis
L’Organisation mondiale de la santé fait état de 12 millions de personnes infectées dont 300 millions de personnes à risque dans quelque 80 pays. Les hôtes réservoirs, tels que les chiens et les rongeurs, jouent un rôle important dans la distribution de l’infection.
Les gens contractent la leishmaniose lorsque leurs activités les rapprochent étroitement des phlébotomes; par exemple, les travailleurs des forêts d’Amérique du Sud sont fréquemment exposés.
La leishmaniose prend de nombreuses formes, en fonction à la fois de facteurs liés à l’hôte et au parasite. Les symptômes peuvent aller d’ulcères cutanés auto-cicatrisants à une maladie grave mettant la vie en danger. La leishmaniose cutanée, connue localement sous divers noms tels que l’ulcère de Bagdad, le furoncle de Delhi ou la plaie orientale, se manifeste par des lésions cutanées qui disparaissent généralement mais peuvent laisser de vilaines cicatrices.
Chez certaines personnes, la maladie se propage aux muqueuses du nez et de la bouche, entraînant une destruction hideuse des traits du visage. La forme la plus dangereuse est la leishmaniose viscérale, où les parasites envahissent les organes internes. Cette maladie est communément appelée kala-azar, un terme hindi pour « maladie noire » qui décrit l’augmentation de la pigmentation de la peau. Les symptômes comprennent de la fièvre et une perte de poids. S’il n’est pas traité, le kala-azar entraîne invariablement la mort. Les récentes épidémies de leishmaniose au Soudan et en Inde ont mis en évidence le problème.

Trypanosomiase
Les protozoaires responsables de la trypanosomose sont étroitement liés aux parasites leishmania. Chez l’homme, différentes espèces du genre Trypanosoma sont responsables de maladies qui sont assez distinctes en termes de résultats cliniques et de répartition géographique.
La forme du Nouveau Monde, la maladie de Chagas ou trypanosomiase américaine, causée par Trypanosoma cruzi , affecte environ 18 millions de personnes vivant principalement en Amérique latine. Le parasite est transmis à l’homme par des punaises reduviides hématophages, également connues sous le nom de punaises des baisers en raison de leur prédilection à se nourrir du visage de leurs victimes.
Contrairement au paludisme et à la leishmaniose, les parasites ne sont pas injectés pendant l’alimentation ; ils sont plutôt déposés en déféquant des insectes. Le parasite pénètre dans l’hôte par les yeux, le nez ou la bouche, ou par des coupures dans la peau. Les symptômes peuvent apparaître comme une maladie aiguë peu de temps après l’infection ou comme une maladie chronique des années plus tard.
La maladie aiguë implique de la fièvre, un gonflement des ganglions lymphatiques et, parfois, une inflammation du muscle cardiaque et du cerveau. Bien que la phase aiguë puisse être fatale, en particulier chez les enfants, la plupart des individus infectés survivent et entrent dans une longue phase sans symptômes.
Un quart ou plus développera des lésions cardiaques pouvant entraîner une insuffisance cardiaque et une mort subite; d’autres peuvent développer des troubles digestifs.
L’ infection à Trypanosoma cruzi n’est pas limitée aux humains et la présence d’autres mammifères infectés est suffisante pour maintenir l’infection dans la nature. Les mesures de contrôle reposent sur la limitation des contacts avec les insectes infectés, car la prophylaxie et le traitement médicamenteux ne sont pas efficaces. Les méthodes de lutte antivectorielle impliquent la pulvérisation d’insecticides et l’élimination des aires de reproduction des punaises.
Les trypanosomes responsables de maladies humaines en Afrique, la trypanosomose africaine ou « maladie du sommeil », sont différents de ceux qui causent la maladie de Chagas. Cette maladie touche quelque 25 000 personnes par an ; cependant, les épidémies impliquant plusieurs fois ce nombre sont bien connues.
Ces parasites sont très étroitement liés aux trypanosomes qui produisent des maladies vétérinaires et empêchent le développement des terres de ranch en Afrique, privant ainsi les gens d’une importante source de nourriture. Ces trypanosomes sont transmis à l’homme par la piqûre de glossines.
Les premiers symptômes comprennent de la fièvre, des maux de tête, des étourdissements et une faiblesse. Plus tard, les parasites envahissent le système nerveux central, provoquant des problèmes neurologiques et psychologiques, notamment des hallucinations, des délires et des convulsions. Non traité, le patient peut devenir comateux et mourir.
Une caractéristique de la biologie des parasites qui a longtemps intrigué les scientifiques est la capacité de ces organismes à échapper à la réponse immunitaire par un processus connu sous le nom de « variation antigénique ».
Grâce à un mécanisme génétique complexe, en cours de décryptage, le parasite est capable de modifier à plusieurs reprises la protéine qui recouvre toute sa surface, gardant ainsi une longueur d’avance sur la capacité du système immunitaire de l’hôte à la reconnaître et à y réagir. L’incapacité de l’hôte à reconnaître ces nouvelles variantes permet au parasite de survivre pendant de longues périodes.
Schistosomiase
Cette maladie est causée par plusieurs espèces de vers plats du genre Schistosoma. Environ 200 millions de personnes sont infectées, dont trois fois plus à risque. On estime que 200 000 personnes (0,1 % des personnes infectées) meurent chaque année, mais beaucoup plus (environ 10 % des personnes infectées) souffrent de dommages chroniques aux organes vitaux, notamment le foie et les reins.
Fait intéressant, bien que le cycle de vie de ce parasite implique également un vecteur invertébré, il n’est pas transmis par la piqûre d’un insecte, mais se développe plutôt dans les escargots d’eau douce. Après avoir quitté l’escargot vecteur, les larves de schistosomes nagent jusqu’à ce qu’elles entrent en contact avec un hôte humain se baignant ou travaillant dans l’eau.
Ils pénètrent dans la peau, puis migrent à travers les vaisseaux sanguins jusqu’à finalement s’établir dans les veines de l’intestin ou de la vessie, selon l’espèce du parasite. Les vers adultes mâles et femelles s’accouplent, s’accouplent et produisent un grand nombre d’œufs, dont certains sont excrétés dans les fèces ou l’urine et se retrouvent dans l’approvisionnement en eau où ils éclosent et terminent le cycle en infectant de nouveaux escargots hôtes.
Les vers adultes ne provoquent pas les manifestations les plus courantes de la maladie. Les œufs qui ne sont pas excrétés mais qui se logent plutôt dans les tissus du corps provoquent des maladies.
Dans un processus connu sous le nom de formation de granulomes, des masses de cellules se forment autour des œufs dans le but de les détruire ; ce faisant, cependant, ces cellules initient un processus de cicatrisation des tissus (fibrose). Dans les formes de la maladie impliquant le foie et les intestins, cela entrave la circulation sanguine et peut entraîner la mort en raison de la rupture des vaisseaux sanguins distendus. Dans la forme impliquant la vessie, la cicatrisation étendue peut entraîner une obstruction de l’écoulement urinaire.
Filariose
Les maladies filariennes mettent rarement la vie en danger ou sont aiguës; ils sont cependant extrêmement débilitants et défigurants, et rendent les personnes affectées dépendantes des autres ou de ressources limitées en matière de soins de santé.
Ces vers ronds sont apparentés au ver du cœur du chien, bien connu des amoureux des animaux dans les zones tempérées. Transmis à l’homme par la piqûre de moustiques infectés, les filaires des genres Wuchereria et Brugia provoquent la filariose lymphatique.
Un milliard de personnes vivent dans des zones où l’on trouve la filariose, et on estime qu’environ 90 millions de personnes sont atteintes de la maladie. Lorsque la femelle moustique infectée se nourrit d’humains, elle injecte les stades larvaires du parasite. Ces larves migrent à travers les tissus et se développent en adultes qui s’installent dans le système lymphatique.
La maladie résulte d’une obstruction étendue et de dommages au système lymphatique. Le résultat final est souvent une accumulation de liquide lymphatique dans les membres, et parfois dans le sac scrotal, ce qui peut provoquer le gonflement grotesque connu sous le nom d’éléphantiasis, d’aine pendante et d’hydrocèle. Les vers mâles et femelles s’accouplent pour produire des millions de descendants appelés microfilaires, qui se retrouvent dans le sang et servent à transmettre le parasite à l’insecte vecteur.
La forme de filariose connue sous le nom d’onchocercose ou « cécité des rivières », causée par Onchocerca volvulus , est transmise par un groupe d’insectes appelés simulies, qui se reproduisent dans les rivières et les ruisseaux rapides.
Quelque 90 millions de personnes sont à risque dans 36 pays, principalement en Afrique et en Amérique du Sud, et 18 millions de personnes sont infectées. Les formes adultes d’ O. volvulus vivent sous la peau, formant des nodules visibles.
La plupart des symptômes de la maladie résultent de la migration des stades larvaires (microfilaires) dans la peau et les yeux. La réaction à ces stades entraîne des démangeaisons intenses et une dermatite défigurante ainsi que des dommages aux yeux, y compris des cicatrices cornéennes. L’onchocercose est une cause fréquente de cécité sous les tropiques, touchant plus de 300 000 personnes.
La lutte contre les maladies en Afrique de l’Ouest a été menée par le Programme de lutte contre l’onchocercose, qui coordonne la libération régulière d’insecticides dans les rivières et les ruisseaux de 11 pays de cette région. Le programme est conçu pour éliminer les stades larvaires du vecteur de la mouche noire. L’ivermectine (Mectizan®), un médicament développé à l’origine pour un usage vétérinaire, s’est avéré être un traitement efficace. Merck, Sharp et Dohme, les fabricants, ont fourni le composé gratuitement à tous les pays où l’onchocercose est endémique.
Protozoaires entériques
Ces parasites protozoaires provoquent une diarrhée persistante et sont généralement contractés par ingestion d’eau ou d’aliments contaminés. Les voyageurs se rendant dans les pays tropicaux peuvent courir un risque accru de contracter ces infections, mais de plus en plus de cas sont reconnus dans des pays comme les États-Unis et le Canada.
La première épidémie de cryptosporidiose dans une garderie a été observée en 1983. En 1993, une épidémie associée à de l’eau potable contaminée s’est produite à Milwaukee, Wisconsin, qui a touché quelque 403 000 personnes.
La cryptosporidiose provoque une diarrhée particulièrement sévère chez les patients atteints du SIDA. Il a été estimé que 10 à 15 % de la diarrhée chronique et de l’émaciation observées chez les patients atteints du SIDA aux États-Unis sont dus à cette infection, alors qu’elle peut représenter jusqu’à 30 à 50 % des diarrhées sévères chez les patients atteints du SIDA dans les pays en développement. Il n’existe toujours pas de traitement adéquat de la cryptosporidiose.
Bien que probablement découvert au tournant du siècle, Cyclospora cayatenensis a en fait été caractérisé et nommé au cours d’études en cours au Pérou. Comme la cryptosporidiose, notre compréhension de l’infection à cyclospora a été influencée par l’épidémie de SIDA et les améliorations ultérieures du diagnostic.
Il semble qu’à l’échelle mondiale, Cyclospora affecte un nombre approximativement équivalent d’individus immunocompétents et immunodéprimés. L’émergence de ce parasite en tant que problème dans les pays développés a été largement reconnue à l’été 1996, lorsque plus de 1 500 cas ont été signalés dans quelque 14 États américains et au Canada à la suite de la consommation de baies contaminées.
Un autre protozoaire d’origine hydrique, Giardia lamblia, qui provoque des maladies diarrhéiques, est désormais reconnu comme l’une des causes les plus courantes de maladies d’origine hydrique chez l’homme, et se trouve également dans le monde entier.
La diarrhée, les crampes abdominales et les nausées sont les symptômes les plus courants de la giardiase. Ceux-ci peuvent entraîner une perte de poids et une déshydratation. Les personnes à risque accru de giardiase comprennent les travailleurs en garderie, les enfants en âge de porter des couches qui fréquentent les garderies, les voyageurs internationaux et les randonneurs ou les campeurs qui boivent de l’eau non traitée provenant de sources contaminées.
On estime que le protozoaire Entamoeba histolytica (en-tah-mee ‘ bah), qui provoque une dysenterie sévère et une maladie du foie, tue jusqu’à 100 000 personnes par an. Ce parasite est présent dans le monde entier, bien qu’il soit particulièrement problématique dans les régions tropicales et subtropicales sous-développées. La principale source de transmission est constituée par les personnes porteuses d’une infection chronique ; les matières fécales infectées par la forme kystique du parasite peuvent contaminer les aliments frais ou l’eau.
Autres protozoaires

Toxoplasma gondii est un parasite protozoaire commun. Il est transmis dans les excréments de chats infectés ou peut être acquis en mangeant de la viande insuffisamment cuite.
Normalement, l’ infection à T. gondii est bénigne, car le système immunitaire empêche le parasite de causer la maladie. Dans la plupart des cas, il peut être confondu avec la « grippe », provoquant des ganglions lymphatiques enflés ou des douleurs musculaires. Mais il peut provoquer de graves troubles neurologiques chez les personnes immunodéprimées, ou chez le fœtus s’il est d’abord acquis par une mère pendant la grossesse.
Trichomonas vaginalis un parasite protozoaire sexuellement transmissible, qui provoque une inflammation des voies vaginales et urinaires et, chez les femmes, a été associé à des issues défavorables de la grossesse.
Autres parasites helminthes des maladies tropicales
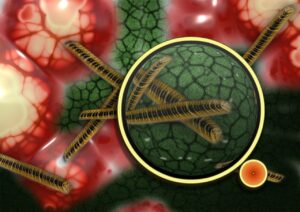 On estime qu’au moins un quart de la population mondiale est infecté par des vers parasites. De nombreuses personnes vivant dans les régions tropicales, où la famine et la malnutrition créent déjà des problèmes de santé, sont infectées par plusieurs de ces helminthes.
On estime qu’au moins un quart de la population mondiale est infecté par des vers parasites. De nombreuses personnes vivant dans les régions tropicales, où la famine et la malnutrition créent déjà des problèmes de santé, sont infectées par plusieurs de ces helminthes.
Ces parasites volent encore plus de sang et de nutriments à leurs hôtes humains; il est facile de comprendre comment ils peuvent affecter le développement physique et mental des enfants et la capacité des adultes à travailler.
Les infections par les ankylostomes surviennent principalement dans les climats tropicaux et subtropicaux. L’infection par l’ankylostome provoque généralement une légère diarrhée ou des crampes. Cependant, une forte infection par ces vers ronds intestinaux hématophages peut provoquer une anémie profonde, entraînant une croissance et un retard mental chez les enfants.
Les gens contractent généralement une infection par l’ankylostome par contact direct avec un sol contaminé, par exemple en marchant pieds nus. Lorsque les œufs passés dans les fèces atteignent le sol, ils éclosent et se transforment en larves infectieuses qui peuvent pénétrer la peau. Les enfants, parce qu’ils jouent dans la saleté et marchent souvent pieds nus, courent un risque particulièrement élevé d’infection.
Les vers Ascaris se trouvent aussi bien dans les régions tempérées que tropicales; en effet, ils sont probablement le parasite le plus commun dans le monde. Alors que le taux de mortalité est relativement faible (estimé à 20 000 par an), l’infection à ascaris peut être débilitante, provoquant des douleurs abdominales et un manque de prise de poids chez les enfants et entraînant parfois une occlusion intestinale.
D’autres vers ronds intestinaux sont également répandus dans les pays en développement. Trichuris affligent environ 750 millions de personnes, et peut provoquer une anémie grave, des douleurs abdominales, des nausées et une perte de poids. Les vers Strongyloides infectent environ 80 millions de personnes et provoquent des douleurs abdominales, des nausées et des diarrhées.
Un autre type de parasite helminthes, le ténia Taenia solium, provoque également une grave maladie humaine. Les porcs et les humains sont touchés par ce ténia.
Généralement, les gens contractent une infection active en mangeant du porc insuffisamment cuit contenant la forme larvaire du parasite. Les larves ingérées se transforment ensuite en vers adultes pondant des œufs dans l’intestin de la personne. Les œufs sortent du corps dans les matières fécales et se propagent dans l’environnement où ils peuvent être ingérés par les porcs, pour poursuivre ce cycle de vie, ou par d’autres humains.
Lorsque les œufs sont mangés par inadvertance par des humains, les larves peuvent infecter le système nerveux central et le cerveau, provoquant de graves troubles neurologiques, notamment des convulsions. Cette maladie, appelée cysticercose après le nom du stade larvaire, est un problème grave dans les zones rurales d’Amérique latine.

































